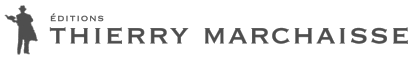Les Médias en parlent
Jean-Marie Schaeffer
|
Essai
20 €, 200 p.
ISBN : 978-2-36280-239-3
Format : 140/205 mm
Parution : 18 juin 2020
Disponible en Ebook (13,99 €)
ISBN : 978-2-36280-239-3
Format : 140/205 mm
Parution : 18 juin 2020
Disponible en Ebook (13,99 €)
Où l'acheter
> en librairie près de chez vous
> sur Place des Libraires
> sur Fnac, Amazon...
> sur la page acheter nos livres
> sur Place des Libraires
> sur Fnac, Amazon...
> sur la page acheter nos livres
Du même auteur
|
Jean-Marie Schaeffer
Lettre à Roland Barthes |
|
Jean-Marie Schaeffer
Petite écologie des études littéraires |
D'autres essais
|
Belinda Cannone & Christian Doumet (sld)
Dictionnaire des mots manquants |
Jean-Marie Schaeffer CRAL, 16 mars 2021
Jean-Marie Schaeffer « De quelques fonctions de la narration »
Séminaire « Recherches contemporaines en narratologie »
Centre de recherches sur les arts et le langage (CNRS/EHESS)
Séminaire « Recherches contemporaines en narratologie »
Centre de recherches sur les arts et le langage (CNRS/EHESS)
Filología Victoria García, vol LIII, 181-184, octobre 2021
Le point de départ de Schaeffer est classique : il revient à Barthes pour interroger le contraste apparent entre la « variété prodigieuse » des récits et leur condition universelle, qui transcende les époques et les contextes culturels. La voie qu'il emprunte pour explorer ce problème est cependant singulière : il choisit d'aborder le phénomène de la narrativité en partant non pas de l'analyse des récits littéraires ou, plus généralement, des discours narratifs publics, mais de l'examen des processus cognitifs dans lesquels la narration est à peine présente ou apparaît à l'état naissant, voire déformée. Schaeffer soutient que l'étude de ces formes limites de la narrativité permet d'éclairer ses modalités canoniques. Ainsi, elle invite à une articulation épistémologique entre narratologie et études cognitives, même quand elle ne méconnaît pas les problèmes que ce dialogue implique, notamment au niveau méthodologique (p.39) : les investigations narratologiques tendent à se passer d'une validation empirique qui, d'autre part, dans l'approche psycho-cognitive est cruciale.
Le concept de proto-narrativité (abordé dans le chapitre homonyme) est à la base de la manière dont l'auteur propose d'aborder les phénomènes narratifs. Il s'agit d'une forme particulière d'organisation ou de traitement des représentations mentales, préalable à la narration –comprise comme acte de communication– et au récit –c'est-à-dire à l'œuvre narrative matérialisée en tant que telle. La mémoire personnelle épisodique, la planification de l'action et l'imagination, la pensée causale spontanée et l'activité onirique sont comprises, pour Schaeffer, dans le territoire des processus proto-narratifs. Dans tous les cas, il s'agit de chaînes de représentations agentives (actions) ou non-agentives (événements), qui impliquent une orientation temporelle et un perspectivisme intrinsèque. Si le premier de ces éléments peut être évident, le second l'est moins : Schaeffer postule, dans ce sens, que le point de vue n'est pas une option de structuration narrative parmi d'autres, mais qu'il est constitutif de la narrativité. La démarche expérientielle à partir de laquelle s'organise mentalement le contenu narratif est toujours celle d'une première personne qui le produit, volontairement ou involontairement.
[...]
Schaeffer cherche à élargir, tout au long de l'ouvrage, la conception traditionnelle des phénomènes narratifs, qui tend à identifier les traits de certaines de ses cristallisations culturelles, notamment les récits de fiction, avec ceux de la narrativité en tant que telle. La question qui ressort de sa démarche est, comme il le prévoit lui-même, d'ordre méthodologique : l'auteur élabore ses conceptualisations à partir de multiples ressources, parmi lesquelles l'examen analytique de textes classiques de la pensée philosophique, la revue bibliographique de travaux récents en psychologie cognitive, l'exemplification avec des œuvres littéraires et artistiques canoniques, et même l'introspection de ses propres processus cognitifs. L'un des moments mémorables du livre est l'évocation de la mort de son père, tombé dans les escaliers du sous-sol de sa maison, dans un épisode qui a constitué pour l'auteur un motif d'imagination rétrospective pendant de nombreuses années.
L'évocation autobiographique renforce l'argument de l'auteur tant sur le plan esthétique – en raison de la puissance de la scène – qu'épistémologique, compte tenu des difficultés posées, comme il le reconnaît lui-même, par les recherches sur les processus cognitifs et sur le lien entre ceux-ci et l'activité neurologique (p.79). La multiplicité des outils d'analyse que rassemble Schaeffer rend compte d'un engagement transdisciplinaire qui, comme nous l'avons indiqué au début, vise à naturaliser la recherche en sciences humaines et sociales. Le programme est ambitieux. Sa réalisation semble donc nécessiter des efforts collectifs et institutionnels divers, au-delà de la ténacité analytique et de la subtilité conceptuelle dont Schaeffer fait une fois de plus preuve dans cette dernière entreprise théorique.
(trad. de l'espagnol)
Accéder à l'article complet en espagnol
Accéder à l'article complet traduit en français
Le concept de proto-narrativité (abordé dans le chapitre homonyme) est à la base de la manière dont l'auteur propose d'aborder les phénomènes narratifs. Il s'agit d'une forme particulière d'organisation ou de traitement des représentations mentales, préalable à la narration –comprise comme acte de communication– et au récit –c'est-à-dire à l'œuvre narrative matérialisée en tant que telle. La mémoire personnelle épisodique, la planification de l'action et l'imagination, la pensée causale spontanée et l'activité onirique sont comprises, pour Schaeffer, dans le territoire des processus proto-narratifs. Dans tous les cas, il s'agit de chaînes de représentations agentives (actions) ou non-agentives (événements), qui impliquent une orientation temporelle et un perspectivisme intrinsèque. Si le premier de ces éléments peut être évident, le second l'est moins : Schaeffer postule, dans ce sens, que le point de vue n'est pas une option de structuration narrative parmi d'autres, mais qu'il est constitutif de la narrativité. La démarche expérientielle à partir de laquelle s'organise mentalement le contenu narratif est toujours celle d'une première personne qui le produit, volontairement ou involontairement.
[...]
Schaeffer cherche à élargir, tout au long de l'ouvrage, la conception traditionnelle des phénomènes narratifs, qui tend à identifier les traits de certaines de ses cristallisations culturelles, notamment les récits de fiction, avec ceux de la narrativité en tant que telle. La question qui ressort de sa démarche est, comme il le prévoit lui-même, d'ordre méthodologique : l'auteur élabore ses conceptualisations à partir de multiples ressources, parmi lesquelles l'examen analytique de textes classiques de la pensée philosophique, la revue bibliographique de travaux récents en psychologie cognitive, l'exemplification avec des œuvres littéraires et artistiques canoniques, et même l'introspection de ses propres processus cognitifs. L'un des moments mémorables du livre est l'évocation de la mort de son père, tombé dans les escaliers du sous-sol de sa maison, dans un épisode qui a constitué pour l'auteur un motif d'imagination rétrospective pendant de nombreuses années.
L'évocation autobiographique renforce l'argument de l'auteur tant sur le plan esthétique – en raison de la puissance de la scène – qu'épistémologique, compte tenu des difficultés posées, comme il le reconnaît lui-même, par les recherches sur les processus cognitifs et sur le lien entre ceux-ci et l'activité neurologique (p.79). La multiplicité des outils d'analyse que rassemble Schaeffer rend compte d'un engagement transdisciplinaire qui, comme nous l'avons indiqué au début, vise à naturaliser la recherche en sciences humaines et sociales. Le programme est ambitieux. Sa réalisation semble donc nécessiter des efforts collectifs et institutionnels divers, au-delà de la ténacité analytique et de la subtilité conceptuelle dont Schaeffer fait une fois de plus preuve dans cette dernière entreprise théorique.
(trad. de l'espagnol)
Accéder à l'article complet en espagnol
Accéder à l'article complet traduit en français
Leonardo Jan Baetens, décembre 2020
Jean-Marie Schaeffer is a key figure of modern French philosophy, mainly working in the field of visual and verbal aesthetics, with major publications on the aesthetic experience and the fundamental categories of art such as genre and fiction. [...]
What makes Schaeffer’s thinking and method so stimulating and helpful, is that he never completely opposes the cognitive and the noncognitive approaches. Cognitive research highlights flaws, illusions, and mistakes in classic narratology, but this is not a one-ay traffic.
The overall conclusion of this book can only be that cognitive studies make an indispensable contribution to our understanding of narrative and that it is high time to make room for it in a broader view of story production and reception, which in itself –and this might be the key lesson of the work– deserves a central position in our ways of defining and doing humanities.
Accéder à l'article complet
What makes Schaeffer’s thinking and method so stimulating and helpful, is that he never completely opposes the cognitive and the noncognitive approaches. Cognitive research highlights flaws, illusions, and mistakes in classic narratology, but this is not a one-ay traffic.
The overall conclusion of this book can only be that cognitive studies make an indispensable contribution to our understanding of narrative and that it is high time to make room for it in a broader view of story production and reception, which in itself –and this might be the key lesson of the work– deserves a central position in our ways of defining and doing humanities.
Accéder à l'article complet
Babelio Patrice Gilly, 30 décembre 2020
Un ouvrage érudit qui prolonge et éclaire les raisons qui nous poussent à raconter, encore et encore. Nous comprenons aussi pourquoi écouter des histoires nous ravit, un goût acquis dès l'enfance. Ce qui est arrivé peut constituer un souvenir, si l'événement nous a marqués, mais la façon dont je restitue les faits n'appartient qu'à moi, c'est mon souvenir, c'est ma vie, que je raconte à ma façon.
Nos récits constituent notre identité. Celle-ci est mobile, en créant des images de soi qui correspondent à des moi différents.
Il faut s'accrocher mais plusieurs passages lumineux démontent les arcanes de la construction de soi par le récit, car la capacité narrative est ancrée dans la biologie humaine (la biologie du cerveau) ; son développement durant la vie individuelle est un processus socialement "élaboré". [...]
Accéder à l'article complet
Nos récits constituent notre identité. Celle-ci est mobile, en créant des images de soi qui correspondent à des moi différents.
Il faut s'accrocher mais plusieurs passages lumineux démontent les arcanes de la construction de soi par le récit, car la capacité narrative est ancrée dans la biologie humaine (la biologie du cerveau) ; son développement durant la vie individuelle est un processus socialement "élaboré". [...]
Accéder à l'article complet
Acta Fabula Laurence Perron, vol. 21, n°9, Octobre 2020
Troubles épistémologiques. Quelles rencontres possibles entre le narratologue & le neuroscientifique ?
Les Troubles du récit donne un tableau historique et théorique de la question proto-narrative, brossé avec le soin et la précision conceptuelle que l’on connait à l’auteur de Pourquoi la fiction?, Qu’est-ce qu’un genre littéraire? et L’Image précaire, pour ne nommer que ceux-là. Encore une fois, J.-M. Schaeffer réussit le tour de force de s’attacher à répondre à une question à la fois large et abondamment traitée sans tomber dans la redite ou le commentaire superficiel, et la finesse de ses efforts typologiques marque l’esprit. Par ses références et ses horizons théoriques, Les Troubles du récit ne témoigne pas moins que les ouvrages antécédents d’une érudition générale et d’une capacité de synthèse époustouflantes, et il faut saluer cette curiosité que l’on sent poindre dans le texte, et que l’auteur a le mérite de rendre communicative. [...]
Accéder à l'article complet
Les Troubles du récit donne un tableau historique et théorique de la question proto-narrative, brossé avec le soin et la précision conceptuelle que l’on connait à l’auteur de Pourquoi la fiction?, Qu’est-ce qu’un genre littéraire? et L’Image précaire, pour ne nommer que ceux-là. Encore une fois, J.-M. Schaeffer réussit le tour de force de s’attacher à répondre à une question à la fois large et abondamment traitée sans tomber dans la redite ou le commentaire superficiel, et la finesse de ses efforts typologiques marque l’esprit. Par ses références et ses horizons théoriques, Les Troubles du récit ne témoigne pas moins que les ouvrages antécédents d’une érudition générale et d’une capacité de synthèse époustouflantes, et il faut saluer cette curiosité que l’on sent poindre dans le texte, et que l’auteur a le mérite de rendre communicative. [...]
Accéder à l'article complet
France Culture La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmeau, 12 sept 2020
Comment on se raconte tout le temps des histoires
Emission "La Suite dans les idées" par Sylvain Bourmeau
Invité : Jean-Marie Schaeffer, rejoint en seconde partie par Lise Charles.
Durée 43 min
Les récits ne se cantonnent pas à la littérature ou au cinéma, ils sont partout et tout le temps. Ils nous permettent notamment d'être au monde et d'agir. Dans « Troubles du récit » Jean-Marie Schaeffer enquête sur ces proto-narrativités. Il est rejoint en seconde partie par l'écrivaine Lise Charles.
(Ré)écouter sur France Culture
Emission "La Suite dans les idées" par Sylvain Bourmeau
Invité : Jean-Marie Schaeffer, rejoint en seconde partie par Lise Charles.
Durée 43 min
Les récits ne se cantonnent pas à la littérature ou au cinéma, ils sont partout et tout le temps. Ils nous permettent notamment d'être au monde et d'agir. Dans « Troubles du récit » Jean-Marie Schaeffer enquête sur ces proto-narrativités. Il est rejoint en seconde partie par l'écrivaine Lise Charles.
(Ré)écouter sur France Culture
Philosophie Magazine Martin Legros, N°142 - Septembre 2020
C’est en s’excusant que Jean-Marie Schaeffer introduit, à la page 175 de son dernier essai, un élément biographique qui donne son poids et sa force à sa réflexion. Son père est mort après une chute dans l’escalier qui menait à la cave de sa maison : sa tête s’est fracassée sur le sol où on l’a découvert baignant dans son sang. Mais, alors que les médecins ont tenté de convaincre Schaeffer que son père était mort sur le coup, celui-ci s’est aperçu avec effroi, lorsqu’il est descendu sur les lieux, qu’il avait eu le temps avant de mourir de poser deux empreintes de ses mains ensanglantées sur le mur. « Mon cœur faillit s’arrêter à l’instant même », écrit-il. Cette vision traumatique va déclencher chez lui une série de films intérieurs où il se rejoue, comme pour l’apprivoiser, la chute tragique de son père. « Mon imagination a fini par parcourir toutes les variantes possibles. Et mon esprit, comme rassuré par le fait que désormais aucun nouvel aspect envisagé ne pouvait se tapir quelque part, a fini par intégrer la mort de mon père dans le monde de ma vie, par me la rendre familière. »
Existentielle et personnelle, cette leçon recoupe la thèse, forte et troublante, de cet essai. [...]
Accéder à l'article complet
Existentielle et personnelle, cette leçon recoupe la thèse, forte et troublante, de cet essai. [...]
Accéder à l'article complet
Yozone Hilaire Alrune, 15 août 2020
Dès l’introduction, l’auteur définit clairement son propos : non pas s’intéresser à une vision unitaire du récit, mais au contraire explorer ses marges, c’est-à-dire “étudier les régions du régime narratif où les catégorisations communes sont prises en défaut, les situations dans lesquelles la notion canonique du récit est troublée.”
[...]
Ardu mais passionnant, richement documenté, agrémenté d’un “Index des notions’’, et d’un “ Index des mots ’’, ce « Troubles du récit » emmène donc le lecteur dans des marges protéiformes qui incitent à réfléchir. Empruntant à la philosophie, aux neurosciences et aux sciences humaines, il explore et défriche des notions et des territoires parfois mouvants, et met en lumière les formes de protonarrativité volontaires ou non – rêves, mémorisations, anticipations – qui constituent une facette importante de nos vies, des protonarrativités à travers lesquelles nous nous projetons et grâce auxquelles nous nous construisons et construisons notre vision du monde.
Accéder à l'article complet
[...]
Ardu mais passionnant, richement documenté, agrémenté d’un “Index des notions’’, et d’un “ Index des mots ’’, ce « Troubles du récit » emmène donc le lecteur dans des marges protéiformes qui incitent à réfléchir. Empruntant à la philosophie, aux neurosciences et aux sciences humaines, il explore et défriche des notions et des territoires parfois mouvants, et met en lumière les formes de protonarrativité volontaires ou non – rêves, mémorisations, anticipations – qui constituent une facette importante de nos vies, des protonarrativités à travers lesquelles nous nous projetons et grâce auxquelles nous nous construisons et construisons notre vision du monde.
Accéder à l'article complet