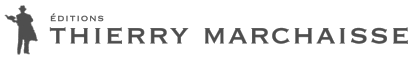|
Mango
16/8/2012 02:53:17 am
Je termine ce livre reçu il y a deux jours à peine et dont la lecture a court-circuité immédiatement toutes les autres programmées bien avant. Dès les premières lignes, impossible de le lâcher. Il m’a emportée dans une autre civilisation, celle de la Mauritanie coloniale puis indépendante des années cinquante à nos jours.
Répondre
Sophie Caratini
16/8/2012 02:56:31 am
Oui, la fille du chasseur a existé ; oui, elle existe. Mariem habite Paris, c’est elle, au départ, qui m’a demandé d’écrire sa vie. Pendant deux ans, j’ai réalisé avec elle, au cours de nos séances de travail hebdomadaires, une véritable maïeutique, fondée sur ma pratique d’anthropologue et ma connaissance de son pays. Ce livre est donc bien plus qu’un simple « témoignage ». Il est issu de nos dialogues et manifeste une sorte d’alchimie entre sa parole et mon écriture, sa jeunesse mauritanienne et mon expérience des sociétés qu’elle évoque. Rien dans ce livre n’est « romancé », ni inventé. A la lecture de la version finale, et malgré la distance obligée par le passage de l’oralité des échanges au texte littéraire, Mariem concluait : « je n’aurai pas changé un seul mot ».
Répondre
beslay patrice
2/5/2015 10:15:05 am
serait il possible d'avoir un contact mail avec Mariem mint touileb ? j'aurais aimé echanger sur quelques personnes ayant vecu à l'époque qu'elle raconte; mon père qui etait au gn de chinguetti, moktar oul ddah son interprète quand il etait dans l'adrar, moktar ould bontemps avec qui j'ai beaucoup "navigué" et m'a tout appris des chameaux, des traces, des plantes et à qui je dois l'amour de ce pays, et quelques autres ould ducrot, ...
Répondre
Marina
16/8/2012 02:56:59 am
J'ai beaucoup aimé "La Fille du chasseur" et je l'ai lu presque d'une traite. Comme Mango, je me suis demandé s'il s'agissait d'un roman, j'ai pensé à "Geisha", ou s'il s'agissait d'un récit de vie restitué par l'anthropologue Sophie Caratini. Il est vrai qu'aucune indication ne permet vraiment au lecteur de répondre à cette question. Mais il est clair que c'est un choix de votre part, et en tant que lectrice, je l'ai trouvé subtil et efficace. J'aimerais vous dire pourquoi et vous demander si vos raisons ont quelque chose à voir avec les miennes.
Répondre
Sophie Caratini
16/8/2012 02:57:14 am
Bonjour Marina, vous avez admirablement saisi nos intentions. Je vous confirme l'exactitude de ce que vous avez compris, mais il vous faut savoir que tout le mérite de cette "subtilité" de la présentation revient à mon éditeur, Thierry Marchaisse, avec lequel nous avons eu des débats infinis sur ces questions de forme... et sur bien d'autres.
Répondre
Etta18
16/8/2012 02:57:44 am
Bonjour, je viens de m'inscrire car je cherchais un forum où il serait question du livre "La fille du chasseur", je ne m'attendais pas du tout à tomber sur l'auteur! Quelle opportunité incroyable!
Répondre
Dimitri
16/8/2012 02:59:11 am
À la lecture de la quatrième, j’avais opté pour une lecture passive afin de me délester au mieux de ce qui pouvait faire écran à une appréhension intuitive de ce que serait Mariem et son milieu. Mon constat est que, dès les premières lignes, on est happé dans une autre dimension culturelle. Cela tient à mon sens, pour partie, à ce style absolument déroutant, fait d’une syntaxe presque rudimentaire assortie d’un lexique qui se contente de décrire l’environnement naturel et humain, avec comme effet de sur dimensionner le réel aux dépens de l’imaginaire et de l’analyse. Nous sommes par ce biais introduit brutalement dans l’univers de Mariem pour qui la nature fait véritablement corps avec sa destinée à ce moment de sa vie, tant il est question de survivre. Il est assez saisissant de voir ensuite, à mesure que la narratrice s’immerge dans une autre culture, via le GN, le style s’affiner, les phrases s’allonger, le lexique devenir plus recherché et faire davantage référence à l’abstrait. Le langage s’« urbanise » enfin pour devenir celui d’une immigrée, gardant néanmoins sa coloration naturelle, et exprime une pensée qui gagne en complexité. Je n’avais encore jamais vu auparavant, si bien rendue, du point de vue diachronique, une telle emprunte de la civilisation sur la langue, ceci en l’espace d’une vie et d’un livre. Étant donné que l’anthropologue ne se laisse entrevoir qu’en de très rares endroits, faut-il en conclure que l’auteur a pu rendre cette particularité grâce à son informatrice, même s’il est probable, qu’établie à Paris, il ne s’agisse plus pour elle que de souvenirs ? Ou bien est-ce un choix littéraire de l’anthropologue qui s’immisce dans le discours de la narratrice pour en restituer l'oralité et ce qui a été perdu ?
Répondre
Sophie Caratini
16/8/2012 02:59:34 am
Bonjour à tous, j'arrive un peu tard. Tout d'abord je réponds à Etta18 : La fille du chasseur est le premier volume d'une trilogie "coloniale" dont l'objectif est de confronter trois points de vue, trois vies représentatives du fait colonial et de ses conséquences sur les parcours des personnes, des sociétés et des cultures. Deux autres livres sont prévus : le second donnera la parole à un ancien tirailleur du GN d'Atar, et le troisième à un jeune officier méhariste dont j'ai précédemment publié un récit uniquement centré sur son passage au GN d'Idjil dans les années trente, mais qui, pour la trilogie, sera élargi à l'ensemble des relations qu'il a construites avec les pays sahariens. Dans un quatrième volume, je reprendrai la parole pour raconter cette incroyable enquête qui a duré près de vingt ans et m'a conduite des campements maures de l'extrême Nord mauritanien jusqu'aux villages peuls des bords du fleuve sénégal.
Répondre
Sophie Caratini
16/8/2012 03:00:01 am
A Dimitri : merci à vous. Je désespérais de parvenir à transmettre à travers l’écriture cette sensation, presque douloureuse, de devoir parcourir à l’intérieur de moi-même un angle de 180° chaque fois que je passe de la France à la Mauritanie, et inversement. Il me semblait qu’il était impossible, par des mots, de faire ressentir à un autre, qui n’aurait pas accompli le voyage, ce que vous nommez très justement une « autre dimension culturelle ». J’ai enregistré Mariem pendant plus de deux ans, j’allais chaque semaine passer une après-midi avec elle, elle préparait le thé, j’allumais le magnétophone, et nous laissions la parole couler librement, c’était un dialogue et non un monologue, quelque chose qui pourrait s’apparenter à la maïeutique. L’écriture du livre a pris des années, il est passé par de multiples phases jusqu’à atteindre ce moment où l’on a l’impression qu’on ne pourra pas aller plus loin sans détruire quelque chose de ce qui a été construit. Mon objectif était d’utiliser l’écriture pour donner non pas à lire mais à entendre Mariem, il fallait que ce soit écrit mais que la lecture donne l’impression d’entendre la voix de la narratrice. Pour ce qui est de l’évolution du style au cours du livre cette « urbanisation » dont vous parlez qui imprègne progressivement la forme de narration, je n’aurais pas espéré réussir à la rendre à ce point perceptible à mes lecteurs, d’autant que de mon côté, je ne pense pas avoir eu la conscience exacte – donc l’intention consciente – de cet effet de style. Je crois que ça s’est fait tout seul, parce que lorsqu’on écrit, on s’identifie à ses personnages, à ce qu’ils vivent, et que justement, cette nature prégnante, cette dureté et en même temps cette douceur, je n’avais pas besoin de les « imaginer », j’avais moi aussi, « derrière », ma part de vécu…
Répondre
Dimitri
16/8/2012 03:00:15 am
J’ai été entre autre retenu par votre témoignage : « […] cette sensation, presque douloureuse, de devoir parcourir à l’intérieur de moi-même un angle de 180° chaque fois que je passe de la France à la Mauritanie ». Est-ce que cela veut dire que l’anthropologue doit abandonner quelque chose de soi identifié à l’autre et à sa culture dans ce passage ? Il me semble, sans bien saisir le lien, qu’il y aurait un rapport avec cette annonce de quatrième qui à retenu mon attention : « […] nous accédons […] aux métamorphoses intérieures de tout un peuple. » Etes-vous sensé vivre en raccourci, brutalement, et donc douloureusement, ce qui est en jeu pour une civilisation en voie de mutation du fait de l’imprégnation souvent discutable d’une autre culture ? Peut-être est-il question du rapport que chacun entretien avec son port d’attache, tellement présent chez Mariem malgré ses « métamorphoses intérieures », et que vous avez si bien rendu perceptible. Cela pose aussi la question de n’être nulle part chez soi, ou partout à la fois, du fait de n’être rien.
Répondre
Sophie Caratini
16/8/2012 03:00:42 am
Je ne saurais répondre à la question de l'identification, même s'il est évident que mon passage en Mauritanie m'a donné en quelque sorte une "deuxième culture", comme les enfants métis. Je ne pense pas "perdre" quelque chose, ou me transformer. Il me semble que c'est le contraire, que c'est pour rester "moi" que je dois effectuer cet angle de 180°. C'est plus une adaptation qu'une métamorphose, adaptation à un mode d'être au monde dont j'ai maintenant l'expérience et qui, d'un côté (européen), serait plus un mode d'être principalement dans l'espace, et de l'autre un mode d'être dans le temps. La civilisation occidentale surcharge l'espace de signes, chacun se projette d'abord dans l'espace, s'identifie aux lieux et à la multitude d'objets qui l'entoure ou dont il se dote et qu'il "charge" de significations. Dans la civilisation nomade, l'important est l'imaginaire, de soi mais surtout des autres car la plupart sont absents, le marquage des lieux est fugace et les objets sont rares. Chacun est mentalement dans un réseau de relations (de soi à soi et de soi aux autres, vivants et morts) inscrites "nulle part", donc dans le temps (la mémoire, les images de l'avenir). Ces deux modes de projection coexistent dans toute civilisation, mais peuvent être inversés. Si l'on prend la définition de Lacan de la réalité, faite, d'après lui, de trois éléments, le réel, le symbolique et l'imaginaire, et si l'on considère que ces trois éléments fonctionnent de manière relative (le réel annihilant toute possibilité de fonctionnement de l'imaginaire lorsqu'il est absolument prégnant, et l'imaginaire omniprésent annihilant toute possibilité de perception du réel), c'est leur combinaison qui change lorsqu'on passe d'une civilisation à l'autre. Surtout si l'on passe d'une civilisation sédentaire à une autre nomade. La "réalité" est différente, cette différence génère, pour que le passage soit effectif, une reconfiguration du rapport à l'espace et au temps. Les "expatriés" occidentaux lorsqu'ils sont en Mauritanie n'effectuent pratiquement jamais le passage, même s'ils restent là-bas des années. La plupart transposent simplement leur rapport culturel à l'espace et au temps là où ils s'installent, ils l'emportent dans leur bagage et ne le lâche pas d'un pouce. Celui qui n 'a que son sac et qui veut entrer dans le monde des nomades, s'il n'adapte pas son rapport au temps et à l'espace au leur, est condamné à rester en lisière. Au début, c'est un effort (cf. le récit de mon premier voyage "Les enfants des nuages", paru au Seuil en 1993). Ensuite, ça devient spontané, la roue tourne pour se mettre automatiquement au bon endroit dès que le corps perçoit l'air, la lumière, les sons et les odeurs de cet "espace" qui n'en est pas un... Il est vrai que cette "faculté" de passage peut développer ou accentuer une sorte de schizophrénie. C'est le prix à payer.
Répondre
Patrick Hervé
16/8/2012 03:32:49 am
De ce livre magistral, beaucoup de critiques en ont parlé et en parleront mieux que moi. Non je ne dirai pas qu’il m’a captivé. Non, il m’a dévoré mais, vous l’avouerai-je, Mariem, fille du chasseur m’a capturé.
Répondre
Françoise Héritier
16/8/2012 03:33:06 am
Chère Sophie Caratini,
Répondre
Quentin
25/2/2013 10:45:06 am
N'auriez-vous pas gagné à expliciter vos hypothèses relatives à ce qu'est une culture?
Répondre
Sophie Caratini
2/4/2013 10:07:09 am
Je ne suis pas certaine que l’on puisse enfermer dans un seul mot tout ce qui participe à définir une culture. Quant aux hypothèses, j’évite d’en avoir, car elles risquent, elles aussi, d’orienter le regard et l’esprit. Ce que j’ai voulu faire, c’est donner à comprendre et à ressentir tout ce qui fait justement « une culture », et démontrer dans le même temps qu’il n’y a pas la culture d’un côté et l’être de l’autre. Pour ce faire, j’ai choisi l’expression littéraire qui permet de mêler le dit et le non-dit, les faits et les émotions. S’agissant des sentiments par exemple, comment savoir jusqu’à quel point « la culture » du sujet prédétermine la signification qu’il va donner au trouble qui l’étreint ?
Répondre
beslay
1/5/2015 03:21:56 am
je retrouve dans ce récit les traces de ce que j'ai vécu il y a quarante ans, lorsque coopérant j'ai eu la chance de parcourir à pieds et à chameau des bouts de l'adrar, du tiris, du tagant, en croisant l'histoire racontée par les anciens de bon nombre de toutes ces tribus citées dans ce livre. merci à ce duo d'écrivain.
Répondre
Jérôme Lombard
27/11/2020 07:10:10 pm
Chère collègue
Répondre
Votre commentaire sera affiché après son approbation.
Laisser un réponse. |
Partager
Cliquez sur un titre pour lire ou laisser un commentaire. Accès par genre
Tous
|