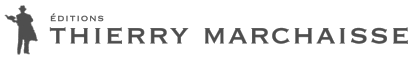|
2 Commentaires
Alain
5/3/2013 03:58:45 am
J'ai particulièrement apprécié ce livre. Parce que les contes sont plaisants à lire pour eux-mêmes, parce qu'ils nous offrent la source du terme "sérendipité" que l'on commence à voir bourgeonner ici et là, et parce que le dossier intitulé "Voyage en sérendipité" est extrêmement clair et instructif, tout en étant d'un style vif et agréable.
Répondre
Dominique Goy-Blanquet
5/3/2013 04:12:32 am
Merci, Alain, de votre lecture attentive et chaleureuse. Merci aussi de rappeler un temps où "les humanités" n'étaient pas restreintes à un cercle de spécialistes au cœur de l'indifférence générale, mais avaient une place dans toute éducation, toute lecture approfondie. Vous répondez vous-même à votre question en suggérant que les savants cités, qui ont introduit le concept en manière de jeu dans leur faculté de médecine, possédaient une culture humaniste. A défaut, il leur suffisait de feuilleter l'Oxford English Dictionary, comme Merton.
Répondre
Votre commentaire sera affiché après son approbation.
Laisser un réponse. |
Partager
Cliquez sur un titre pour lire ou laisser un commentaire. Accès par genre
Tous
|